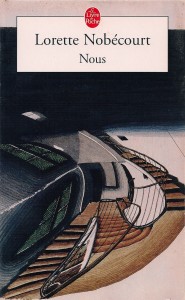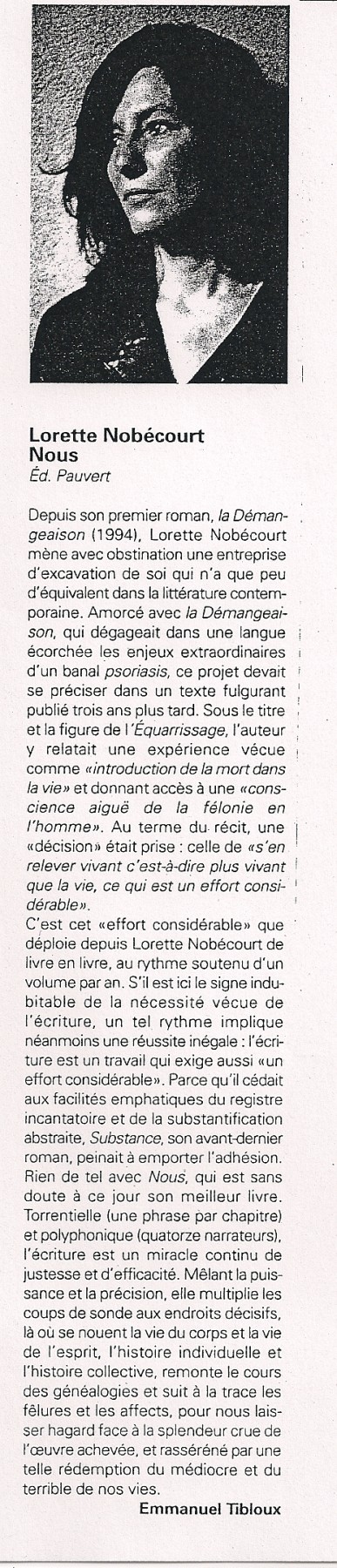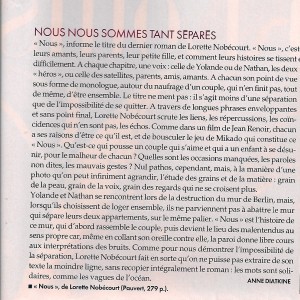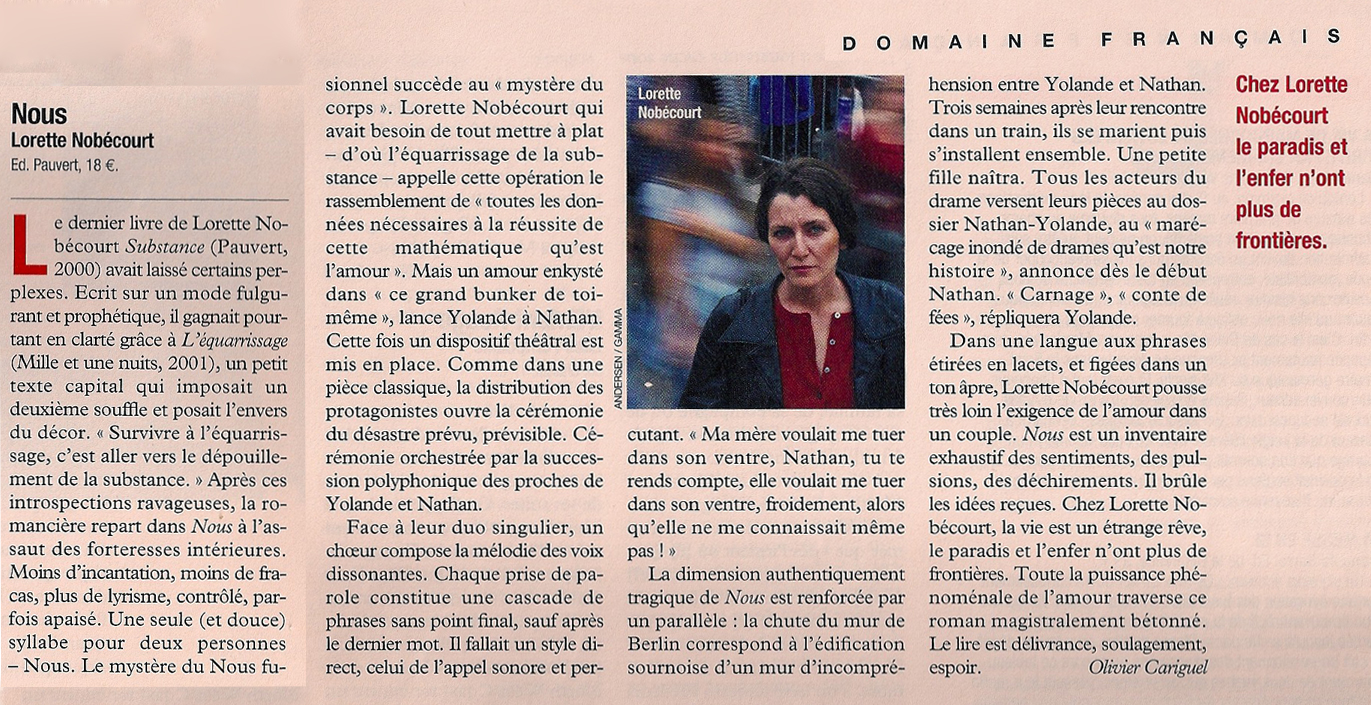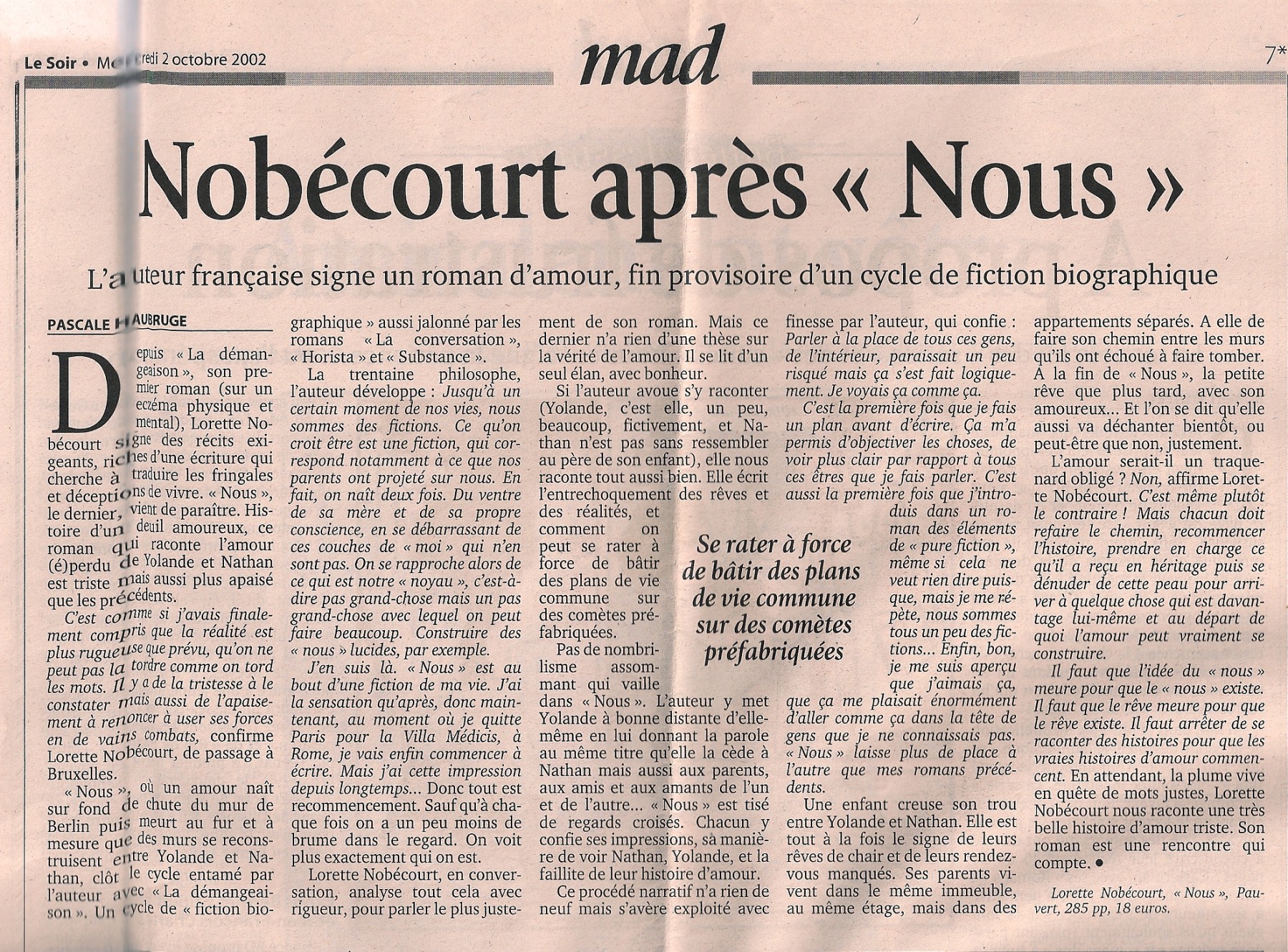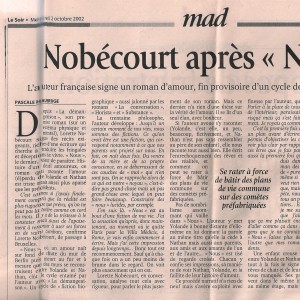Nous
Éditions Pauvert, 2002 - Sous le nom de Lorette Nobécourt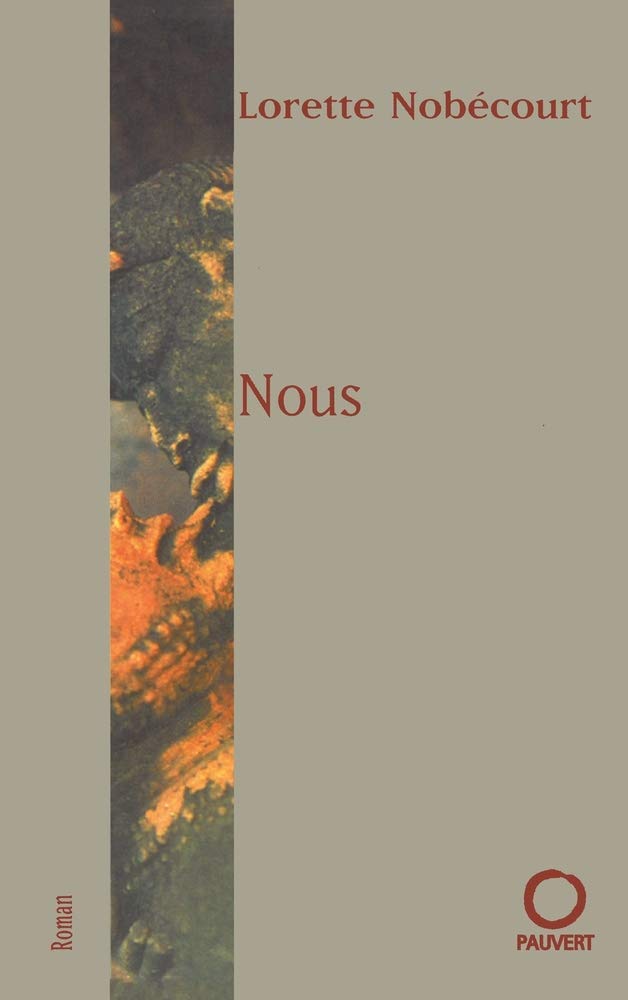
Incipit
«Yolande
Ils étaient mille et cent dans ce train pour Berlin, La nuit, le jour, et sans bagages, dans les wagons, amassés sur le quai, mille et cent, tu te souviens Nathan, le Paris-Moscou de seize heures quarante-quatre, ce samedi, le contrôleur pressé mais heureux, oui, il y avait cet évènement-là du contrôleur heureux dans cette masse confuse d’humanité qui s’apprêtait à partir, heureux au milieu des gens, de cette mère qui repartait vers l’Est, cette fille avec son journal sous le bras, ses cheveux d’or en bataille sur ses épaules fragiles, cet homme et son regard trop noir, statique, troué comme celui d’un canon, ils voulaient tous voir de leurs propres yeux, l’adolescent aussi et cette femme encore, cinquante-trois ans, elle me l’a dit, originaire de l’Estonie»
4e de couverture
L’annonce est faite : le mur de Berlin est tombé. Un séisme mondial, la chance de se rapprocher. Une jeune femme, le cœur curieux, prend le train pour assister à l’événement. Au retour, un homme la regarde. C’est l’amour immédiat. Il attend, la rappelle, la revoit à Paris.
Ils emménagent sur le même palier, dans deux appartements voisins mais séparés. Ils auront un enfant, une petite fille. Sur ce palier, au fil des ans, va s’élever leur mur, bâti pierre après pierre, témoin d’une guerre froide qu’ils mènent avec acharnement.
Il y a le choeur des familles, des maîtresses, des amants, aves leurs secrets enfouis depuis des générations, les non-dits qui font écran aux promesses de bonheur du couple – Yolande et Nathan.
C’est ce travail de sape, effritant l’effort permanent de l’amour, que l’écriture polyphonique de Lorette Nobécourt imite à la terrible perfection. Jusqu’à laisser au corps glorieux la seule issue d’un désastre – et la chance d’un recommencement.